Compte-rendu détaillé et argumenté sur le rapport « Frères musulmans et islamisme politique en France » et qui en montre la partialité et le potentiel danger qu’il porte contre le vivre-ensemble et plus largement contre les idéaux républicains. L’autrice, Aurore Nerrinck est médiatrice culturelle, formatrice et éditrice. Son travail articule l’histoire de l’art, l’archéologie, l’anthropologie et les enjeux contemporains qu’elle explore, notamment autour des questions de pouvoir, de justice sociale, de mémoire et de spiritualité critique.
J’ai lu le rapport « Frères musulmans et islamisme politique » en France, commandé par le Président de la République et publié en mai 2025 dans un contexte de crispation politique et sécuritaire. Voici mon analyse.
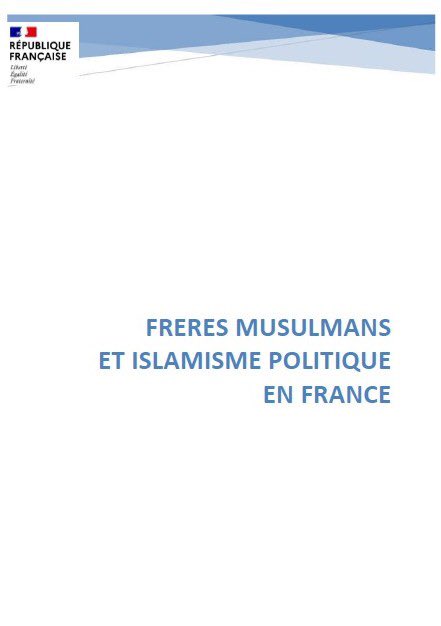
– Une illégitimité académique manifeste
A bien des égards, ce rapport constitue une production idéologique, politiquement instrumentalisée, méthodologiquement faible, et structurellement à charge, qui mobilise le vocabulaire de la recherche pour soutenir une stratégie de désignation, de surveillance et de disqualification.
Sur le fond comme sur la forme, le rapport viole plusieurs principes fondamentaux de la recherche publique :
• Absence de pluralité : aucune parole issue des milieux visés n’est interrogée ni restituée. Les dynamiques internes, les tensions doctrinales, les contradictions sont invisibilisées.
• Références floues, méthodologie opaque : les sources ne sont pas toujours identifiables avec précision, les citations ne sont pas systématiquement contextualisées, et l’articulation méthodologique reste lacunaire. On est loin des standards exigés d’un travail universitaire sérieux.
• Postures idéologiques non discutées : des notions controversées comme « l’islamophobie » sont décrites comme de simples outils de victimisation ou de stratégie militante, sans prise en compte de leur reconnaissance juridique (ex. rapport de la CNCDH) ou de leur traitement sociologique dans la recherche internationale.
Ce biais est renforcé par le recours à des sources provenant de think tanks sécuritaires ou de groupes d’influence politique, souvent financés par des réseaux conservateurs voire d’extrême droite, comme le Gatestone Institute, l’Austrian Documentation Centre ou Policy Exchange. Aucun croisement avec d’autres approches (notamment en sociologie, anthropologie ou science politique critique) n’est proposé, accentuant la lecture à sens unique.
Ce rapport ne produit pas de savoir, il construit une accusation. Il ne procède pas par démonstration, mais par suspicion. Il n’analyse pas, mais il oriente.
– Une commande présidentielle : confusion grave entre expertise et pouvoir
En premier lieu, ce rapport n’est pas un travail académique libre : il est commandé par le Président de la République, dans une logique stratégique de lutte contre le « séparatisme ». Cette origine confère au rapport une dimension stratégique, au service d’une politique de désignation, de contrôle et de marginalisation de certains courants religieux et militants.
– Une production sans savoirs : un recyclage à visée stratégique
Aussi, ce qui frappe à la lecture du rapport, c’est qu’on n’y apprend rien. Aucun éclairage inédit, aucune mise en perspective rigoureuse, aucun croisement disciplinaire ne permet de renouveler la compréhension du sujet. Le rapport ne produit aucun savoir neuf : il aligne des éléments déjà largement médiatisés ou institutionnalisés, les agence selon une hypothèse de départ idéologique, et les reconfirme en boucle.
Encore une fois, ce n’est pas une recherche, mais une opération de confirmation. Un exercice de renforcement discursif, qui valide ce que l’on veut prouver. Le document n’éclaire pas mais désigne ; il n’analyse pas mais accuse. Et c’est précisément ce qui en fait un instrument politique, et non un travail scientifique.
– Des apports mineurs, vite neutralisés par la lecture à charge
On peut reconnaître au rapport certains apports documentaires : un effort de cartographie des réseaux transnationaux, des données sur la structuration institutionnelle de certains courants islamistes, ou encore une mise en contexte historique – certes partielle – de l’implantation de ces dynamiques en Europe. À plusieurs reprises, le texte admet aussi, à demi-mot, les lacunes de l’État français en matière de dialogue avec les représentants musulmans, ou les tensions générées par un vide institutionnel prolongé. Ces éléments pourraient, dans un autre cadre, nourrir un débat pluraliste et informé. Mais ici, ils sont rapidement absorbés dans une lecture univoque. Le cadrage général – marqué par la suspicion, le soupçon de dissimulation, l’idée de subversion larvée – neutralise toute portée analytique de ces données. Les faits, même valides, sont systématiquement réinterprétés à travers un prisme idéologique orienté, sans jamais ouvrir la possibilité d’une lecture alternative. Ce qui pourrait nourrir la complexité sert ici à renforcer une logique de disqualification. C’est là que réside la limite structurelle du rapport : même ses apports ponctuellement intéressants sont instrumentalisés pour consolider une démonstration à charge.
– Passages minoritaires : reconnaissance marginale des exclusions systémiques
On ne peut non plus ignorer que le rapport contient, à la marge, quelques passages qui proposent des pistes potentiellement constructives. Il est notamment question de renforcer l’enseignement de l’islam à l’université, de valoriser l’apprentissage de l’arabe, de doter l’école publique de moyens accrus et de casser les ghettos sociaux. Le texte reconnaît même, à un moment, que les musulmans en France peuvent légitimement se sentir marginalisés, notamment en raison de certaines positions diplomatiques françaises, ou d’un climat de défiance généralisée. Il s’agit là de rares effets de reconnaissance des dynamiques systémiques d’exclusion.
Mais ces éléments, bien que présents, sont isolés, non développés, et insérés dans une démonstration largement à charge. Leur existence n’annule en rien le caractère profondément orienté du rapport. Ils apparaissent davantage comme des notes de bas de page que comme des propositions structurantes, vite absorbées par un cadrage général marqué par la suspicion, le soupçon de duplicité, et l’obsession du contrôle.
Par honnêteté intellectuelle, il convient de mentionner ces ouvertures. Mais elles ne suffisent ni à équilibrer la lecture, ni à atténuer les risques qu’un tel texte fait peser sur le débat démocratique.
– Des affirmations infondées et généralisantes : le cas du « voilement des petites filles »
Parmi les nombreux partis pris du rapport figure l’idée d’une « généralisation du voilement des petites filles dès l’âge de 5-6 ans ». Cette affirmation est gravement trompeuse, car elle repose sur aucune donnée statistique sérieuse, aucune enquête représentative, et aucune méthodologie transparente. Elle alimente un imaginaire alarmiste, fondé sur l’exception érigée en norme, et contribue à construire un discours d’alerte sans fondement empirique.
En diffusant ce type de raccourci, le rapport participe d’un discours anxiogène, où les enfants deviennent les symboles d’un supposé endoctrinement religieux, sans preuve, sans contextualisation, et sans pluralité des regards. Cela relève moins de la recherche que de la rhétorique politique, et renforce les stéréotypes les plus virulents à l’égard des familles musulmanes.
Ce genre d’affirmation, présenté comme une évidence, est symptomatique du fonctionnement du rapport dans son ensemble : il énonce, accuse, projette, mais ne démontre pas.
– Le ciblage du monde associatif : un renversement de la responsabilité
L’un des effets les plus inquiétants du rapport est son ciblage du tissu associatif, en particulier éducatif et culturel. Ces structures sont décrites comme des vecteurs d’influence idéologique, voire comme des instruments d’endoctrinement ou d’entrisme. Or ce que le rapport évacue totalement, c’est que ces associations sont nées, dans leur grande majorité, comme des réponses à des carences institutionnelles. Elles interviennent là où l’État a failli, dans des quartiers relégués, auprès de publics discriminés, souvent pour compenser l’inégalité d’accès aux droits, à l’éducation, à la culture, à l’emploi.
Leur action relève le plus souvent d’une logique de justice sociale, non d’un projet politique caché. Les pointer du doigt, sans jamais interroger les inégalités systémiques qui ont rendu leur existence nécessaire, revient à renverser la charge de la preuve, et à blâmer les mécanismes de survie plutôt que les causes du mal. Ce glissement est non seulement injuste : il est dangereux, car il contribue à affaiblir les rares relais d’émancipation disponibles dans certains territoires, au nom d’une logique sécuritaire aveugle.
Ce n’est pas l’associatif qui menace la République. C’est l’abandon républicain qui a nécessité son émergence.
– Une dérive de la laïcité : la neutralité instrumentalisée
Le rapport affirme défendre la laïcité, mais il en propose une lecture profondément dévoyée. En amalgamant religiosité, engagement politique et subversion supposée, il transforme un principe de neutralité de l’État en outil d’exclusion ciblée. Plutôt que de rappeler sa vocation première – garantir la liberté de conscience et l’impartialité de l’État – il la mobilise comme un outil de surveillance, voire de mise à l’épreuve de certains citoyens. En amalgamant religiosité visible, engagement politique critique et menace de subversion, il transforme la laïcité en critère de loyauté et en instrument d’exclusion ciblée.
Dans cette logique, une pratique religieuse exprimée collectivement devient suspecte en soi. La neutralité de l’État est confondue avec une exigence de neutralité imposée aux individus. Ce glissement est dangereux : il fragilise le cadre pluraliste et transforme un principe protecteur en mécanisme de disqualification, incompatible avec les fondements démocratiques qu’il est censé garantir.
– L’instrumentalisation implicite de la question palestinienne
La cause palestinienne, lorsqu’elle est évoquée, ne l’est pas pour ce qu’elle représente – une lutte anticoloniale, un engagement politique ou humanitaire – mais comme marqueur d’adhésion à un islamisme radical. Ce glissement est profondément dangereux : dans un contexte de criminalisation croissante de la solidarité pro-palestinienne, cette lecture contribue à la disqualification des mouvements antiracistes et internationalistes.
En agissant ainsi, le rapport outrepasse les principes de la laïcité : il prend position dans un débat international complexe, définit les frontières du politique autorisé, associe des causes à des risques religieux. Cela constitue, au sens strict, une atteinte à la laïcité : non pas de la part des militants, mais de la part de l’État lui-même.
– Un cadre politique assumé : vers un contrôle généralisé
Le rapport ne se contente pas de dresser un constat. Il propose un plan d’action politique : exclusion des financements publics, fichage, contrôle des formations, disqualification dans l’espace public. Il s’inspire ouvertement de politiques étrangères (Autriche, Royaume-Uni) critiquées pour leur brutalité et leur inefficacité. Cette dimension n’est pas présentée comme une hypothèse ou une voie parmi d’autres : elle est posée comme évidence.
L’objet de la recherche n’est donc pas la compréhension, mais la gestion, la normalisation et l’endiguement d’un phénomène supposé menaçant – sans preuve directe, souvent par inférence, et toujours sans contradiction.
– Un amalgame latent, mais systématique
Le cœur du rapport repose sur un amalgame, parfois subtil, souvent explicite, entre :
• islam politique et salafisme,
• réseaux transnationaux et pratiques religieuses locales,
• revendications identitaires et subversion,
• critique de la laïcité et projet anti-républicain.
L’effet produit est celui d’un continuum menaçant, où toute forme d’expression musulmane organisée – même pacifique, même intégrée aux dispositifs institutionnels – peut être perçue comme suspecte, voire dangereuse. Cela rend impossible toute lecture pluraliste ou différenciée.
– Un climat politique délétère : ce que ce rapport permet
Ce rapport arrive dans un moment marqué par :
• la loi sur le séparatisme (août 2021),
• la dissolution d’associations (CCIF, Barakacity, etc.),
• l’interdiction de manifestations pro-palestiniennes,
• la disqualification des chercheurs critiques,
• la surveillance des pratiques religieuses visibles.
Et donc dans un moment politique et médiatique particulièrement critique, où la désignation des musulmans comme problème de sécurité intérieure est devenue un reflexe institutionnalisé, convergeant vers une normalisation du soupçon.
Dans un tel contexte, publier un document aussi orienté, sous une bannière scientifique, avec l’onction du pouvoir exécutif, n’est pas anodin : c’est activer une mécanique de légitimation pseudo-rationnelle d’un projet sécuritaire, et contribuer à la mise en silence ou en marginalité d’une partie de la population. Ce rapport ne décrit pas un phénomène : il participe d’un glissement politique en cours.
Il faut mesurer la portée de ce texte non seulement à l’aune de ce qu’il dit, mais à l’aune de ce qu’il autorise. Et ce qu’il autorise – par le vocabulaire, par les amalgames, par la posture – c’est une logique de désignation, de surveillance, et de restriction des libertés, sous couvert d’analyse savante.
– En résumé
Ce rapport n’est ni un outil de compréhension, ni un travail scientifique. Il constitue une production politique, au service d’une logique sécuritaire. Il masque son orientation idéologique sous l’apparence de la neutralité académique, tout en étant utilisé pour justifier des politiques d’exception. C’est un instrument de désignation et de disqualification.
Cela engage la responsabilité de l’État, mais aussi celle du champ intellectuel, face à une dérive autoritaire de plus en plus visible.

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.